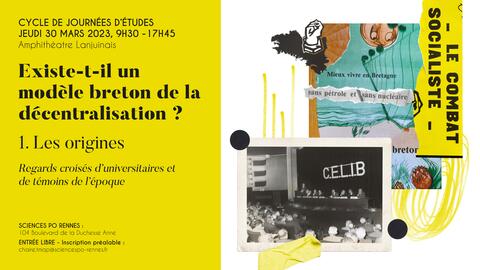Les villes en devenir sont de manière quasi universelle marquées par le développement de zones pavillonnaires réalisées sur des lotissements parcellaires privilégiant l’occupation individuelle à un rythme élevé.
Pourtant depuis la deuxième partie du XIXème siècle, notamment à travers les opérations liées à la révolution industrielle des aménagements alternatifs ont été réalisés qui différent de ce modèle hérité de l’antiquité à partir du modèle du camp romain, et reproduit depuis partout dans les extensions des empires (hors islam et Chine) et plus récemment dans les villes en devenir.
Ces cités ouvrières (qui accueillent également les cadres des entreprises) sont issues d’une approche paternaliste. Elles répondent aux conditions de logements insalubres de la classe ouvrière par une autre manière d’accueillir les membres d’une communauté à vocation économique dans des bâtiments de logements collectifs de qualité, accompagnés par des équipements et services de proximité.
Ce mouvement repris par la puissance publique après la première guerre mondiale s’est traduit dans un urbanisme fonctionnel, de la cité idéale de Tony Garnier aux machines à habiter de Le Corbusier et plus récemment dans des cités sociales et des zones d’accueil pour les populations aux revenus modestes.
La poursuite de l’approche pavillonnaire pour les classes populaires a été théorisée et réalisée dans le cadre des cités jardins en Grande Bretagne en Allemagne et aux Etats-Unis, comme un support au développement de l’automobile, filière de consommation massive de l’énergie pétrolière.
Numériquement, le deuxième modèle a largement surpassé le système fonctionnel, et s’est généralisé dans les États devenus indépendants à partir des années 60, qui y voient un gage de modernité reproduisant ainsi le modèle dominant pour les élites de la période coloniale.
Ce dispositif n‘est pas sans qualité pour la vie individuelle et pour l’exercice de la liberté dans la cadre de la cellule familiale. Il est cependant de plus en plus inadapté face à la demande et aux capacités contributives des ménages y compris pour les revenus moyens inférieurs d’une part, et par son impact environnemental lié à son accessibilité et à l’artificialisation croissante de territoires agricoles et naturels. De nombreux responsables issus de l’ensemble de la chaine de la production de la ville, recherchent une nouvelle orientation vers un modèle urbain plus durable. Celui-ci nécessite de changer de pratiques dans de nombreux domaines.
Les principes de ce changement ont été théorisés au niveau international lors de la conférence Habitat III tenue à Quito en octobre 2016 et transcrites dans un nouvel agenda urbain. La ville et les communautés locales devraient répondre désormais aux principes suivants :
- Durabilité : compacte décarbonée et productive
- Résilience : solidaire et réconciliée avec la nature
- Inclusivité : droit au logement
- Éthique : accessible et raccordée
Pour répondre aux principes et questionnement sur ce changement de modèle et tendre vers une meilleure occupation de l’espace, ont été mobilisés plusieurs experts dans les domaines de l’habiter, de la planification urbaine et de la production de la ville.
Intervenants
- Christine Leconte, Architecte, Ancienne Présidente de l’Ordre national des Architectes
Changer la production de l’habiter
- Vincent Fouchier, Directeur Prospective et Conseil de Développement, au sein de la Direction Générale des Services, Métropole Aix-Marseille-Provence
Intensifier la production urbaine
- David Miet, Co-fondateur et Directeur Général Villes Vivantes, Urbaniste, Docteur en architecture
Changer la fabrique urbaine
Participants
M1-M2 des parcours ISUR, GMM, IN SITU et AGIR.
Programme
- 14h00-14h15 : accueil
Pablo Diaz, Directeur Sciences Po Rennes
Introduction à la séance : Alexis Alamel, Aurélie Jehanno, Gwenaël Leblond-Masclet, Mathieu Dubois, Sarah Tanke
Modération : Xavier Crépin, École urbaine villes et environnement urbain
- 14h15-15h00 : interventions
- 15h00-15h30 : table-ronde
- Comment développer l’intensification urbaine ?
- Quels sont les vecteurs de cette transformation ?
- 15h30-15h55 : questions/réponses, synthèse et clôture
Nicolas Escach, Géographe, Adjoint Maire de Caen, Directeur antenne Sciences Po Rennes Caen
Aurélie Jehanno, Xavier Crépin