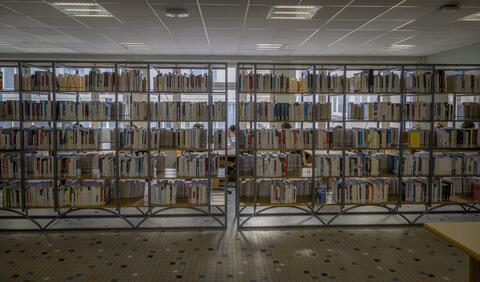
Le droit d'auteur
Le droit d’auteur est régi par le Code de la propriété intellectuelle et la loi DADVSI.
Il vise à protéger l'oeuvre de l’utilisation qui peut en être faite. L’auteur détient des droits moraux et des droits patrimoniaux.
Votre travail de recherche doit respecter le droit d'auteur sur quatre points essentiels :
- Respect de l'intégrité de l'oeuvre
Vos citations textuelles ne doivent pas modifier le sens ni la forme du texte original (droit moral)
- Respect du nom
Vous devez toujours nommer l'auteur du texte original que vous citez (droit moral)
- Droit de citation (exception aux droits patrimoniaux)
Vous êtes autorisé à l’analyse et aux citations brèves, « sous réserve que soient indiqués clairement la source et le nom de l’auteur » (article L122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle)
- Droit de reproduction (exception aux droits patrimoniaux)
Vous ne pouvez pas reproduire ni photocopier plus de 10% du contenu d'un ouvrage et 30% du contenu éditorial d'une revue ou d'un journal (droit patrimonial). La loi autorise cependant la reproduction d'une oeuvre acquise légalement, dans le cadre strict de la copie privée (article L122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle)
Si vous intégrez des illustrations dans votre travail, vous devez en avoir le droit, que ce soit pour des images, des photographies mais aussi des graphiques.
Privilégiez des images libres de droit (licences Creative Commons, vos propres images,...), en gardant à l'esprit que leurs auteurs doivent dans tous les cas être cités.
Pour les images non libres de droit, si vous choisissez de diffuser votre travail sur internet il faudra impérativement recueillir les droits d'utilisation auprès des ayants droit. Si ce n'est pas fait vous devrez supprimer ces illustrations du fichier destiné à la diffusion.
Fiche synthétique "Images et droit d'auteur" du GTSO Couperin
Éviter la plagiat
D'après le CNRTL, le plagiat est une "oeuvre faite d'emprunts ; reproduction non avouée d'une oeuvre originale ou d'une partie de cette dernière."
Le plagiat consiste à s’approprier le travail d’un auteur sans le citer, en paraphrasant ou en reproduisant son œuvre.
Le plagiat peut résulter d’une intention délibérée ou d’une négligence dans la rédaction d'un travail de recherche.
Juridiquement, le plagiat est considéré comme une infraction au droit d’auteur et peut être assimilé à un délit de contrefaçon.
Pour éviter le plagiat, il est nécessaire de toujours mentionner la source de l’information, dès lors qu’on fait référence aux travaux d’un auteur grâce auxcitations et références bibliographiques.
En plus de la dimension juridique (en contrevenant au droit d'auteur) et à la dimension déontologique (éthique scientifique), le risque disciplinaire s'ajoute (annulation du diplôme, interdiction de se réinscrire dans un établissement d'enseignement supérieur).
- Le fait de rendre un mémoire universitaire est partie intégrante de la formation.
- Un plagiaire sera sujet à la suspicion sur l'ensemble de ses travaux, entraînant ainsi la remise en cause de ses connaissances et compétences.
Le plagiat nuit à la crédibilité scientifique des travaux et empêche le lecteur d'accéder à des sources qui pourraient enrichir sa propre réflexion.
InfoTrack est une plateforme de la Bibliothèque de l’Université de Genève (UNIGE) dédiée à la formation en ligne aux compétences informationnelles.
L'Université du Québec a élaboré un quiz et trois études de cas pour vous tester sur le plagiat :
Citer ses sources
Citer ses sources dans un travail universitaire est crucial pour plusieurs raisons :
- Crédibilité et fiabilité : En citant vos sources, vous montrez que votre travail est basé sur des recherches solides et que vous vous appuyez sur des experts du domaine.
- Éviter le plagiat : Citer correctement les sources permet de donner crédit aux auteurs originaux et d’éviter le plagiat, infraction académique grave.
- Vérifiabilité : Les citations permettent aux lecteurs de vérifier les informations et de consulter les sources originales pour approfondir leurs connaissances.
- Contribution à la recherche : En citant vos sources, vous participez à la conversation académique en reconnaissant les travaux antérieurs et en situant votre propre recherche dans un contexte plus large.
La citation doit être reproduite textuellement en retranscrivant ponctuation, majuscules, fautes, coquilles ainsi que la mise en forme (gras, italique, souligné). Toute modification apportée à la citation doit figurée entre crochet [ ].
- La citation de moins de trois lignes sera insérée dans le texte et mise entre guillemets (« »).
«Lire à voix haute en présence d’une autre personne impliquait une lecture partagée, délibérément ou non.1»
_____________________________
1 Alberto Manguel, Une histoire de la lecture, Paris, Actes Sud, Montréal, Leméac, 1998, p. 70.
- La citation de plus de trois lignes devra :
-clairement se détacher du corps du texte,
-ne pas être incluse entre guillemets,
-avoir une taille de police réduite pour que les caractères soient plus petits,
-être en retrait de 1 cm à 1,5 cm à droite et à gauche par rapport au cours du texte général,
-être accompagnée d'une note qui indique la référence bibliographique dont le texte est extrait.
- La citation d'un extrait en langue étrangère :
-On cite l'extrait dans sa langue originale et on applique les règles de citation habituelles.
-On choisit de traduire soi-même l'extrait : on devra indiquer la mention de [traduction libre] ou [Notre traduction].
-On choisit de citer une traduction déjà publiée : on devra indiquer le nom du traducteur et la date de traduction dans la référence.
Inclure un extrait de texte ou reprendre l’idée d’un auteur est autorisé à la seule condition de citer la source et de mettre en évidence l'extrait cité.
- Dans le texte : Vous insérez un appel de citation à l’endroit où vous utilisez une information provenant d’une source. Cet appel peut être sous forme de parenthèses avec le nom de l’auteur et l’année de publication [ex. : (Dupont, 2020)] ou sous forme de numéro renvoyant à une note de bas de page.
- Correspondance avec la bibliographie : Chaque appel de citation dans le texte renvoie à une référence complète dans la bibliographie à la fin de votre document. Cette référence contient tous les détails nécessaires pour identifier et retrouver la source (auteur, titre, année de publication, etc.).
- Styles de citation : Il existe différents styles de citation (APA, MLA, Chicago, etc.), chacun ayant ses propres règles pour formater les appels de citation et les références bibliographiques.
En résumé, l’appel de citation permet de lier les informations utilisées dans votre texte aux sources originales, facilitant ainsi la vérification et la consultation des sources par les lecteurs.
Principes généraux de citation. Université de Laval. [consulté le 27/11/24] https://www.bibl.ulaval.ca/services/redaction-et-citation/citation-de-sources-v2/principes-generaux-de-citation
Citer les sources. INSA, Lyon. [consulté le 17/11/24] https://referencesbibliographiques.insa-lyon.fr/content/appeler-citation-1
Rédiger une bibliographie
Les références bibliographiques peuvent être classées :
- par ordre alphabétique d’auteurs ou de titre (quand il y a plus de 3 auteurs),
- par ordre numérique (numéro de la citation), selon le système adopté pour l’appel de citation aux références bibliographiques,
- il est également possible de classer les références par thèmes, périodes ou supports.
Quel que soit le système adopté, la présentation des références doit rester homogène.
Ouvrage avec un ou plusieurs auteurs principaux
Sont obligatoirement mentionnés les éléments suivants : auteur(s), titre, lieu, nom et date d'édition, mention d'édition si il ne s'agit pas d'une première édition. Vous pouvez, dans un souci de complétude, ajouter la pagination, la collection, le numéro dans la collection, l'ISBN...
Les références bibliographiques doivent être classées par ordre alphabétique d'auteurs.
BARD, Christine. Les femmes dans la société française au XXème siècle. Paris : Armand Colin, 2000. 285 p. (U. Histoire).
Contribution à un ouvrage
GASPARD, Françoise. "L’antiféminisme en politique". In BARD, Christine (dir.). Un siècle d’antiféminisme Paris : Fayard, 1999, p. 339-354
Ouvrage en ligne
MICHEL, Andrée. Le féminisme [en ligne] Paris : PUF, 2007 [https://doi.org/10.3917/lcb.bard.2023.01] (Il n'est pas nécessaire d'indiquer une date de consultation pour un DOI, identifiant pérenne, mais il peut l'être pour une URL susceptible d'être modifiée dans le temps)
Pour les documents non imprimés (en ligne, multimédia...), il est nécessaire de faire apparaitre entre crochets le type de support.
De plus, concernant les documents en ligne, il faut obligatoirement faire apparaitre l'url et la date de consultation.
Ouvrage collectif
Si il y a plus de 3 auteurs principaux, on ne les mentionne pas ou on utilise la mention et al. après les trois premiers.
Le siècle des féminismes. Paris : Ed. de l’Atelier, 2004, 466 p.
OU
GUBIN Eliane, JACQUES Catherine, ROCHEFORT Florence, et al. Le siècle des féminismes. Paris : Ed de l’Atelier, 2004, 466 p.
Ouvrage collectif avec direction d'ouvrage
THÉBAUD, Françoise (dir.). Histoire des femmes en occident. 5. Le XXème siècle. Paris : Plon, 1992, 647 p.
Article de périodique
« L’avenir politique du féminisme », Cités, nº 9, 2002, p. 77-110
DVD
BERTUCCELI, Julie (réal.) Antoinette Fouque : qu’est-ce qu’une femme ? [document multimédia]. Paris : Ed. vidéo France Télévisions distribution, 2010, 1 film 525 min
Ressources utiles
- Prévenir le plagiat [En ligne]. INSA Lyon [consulté le 27/11/24]. Disponible : https://referencesbibliographiques.insa-lyon.fr/content/est-ce-que-je-plagie
- Infosphère [en ligne]. UQAM [consulté le 27/11/24]. Disponible : https://infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/citer-ses-sources/
- Disponible à la bibliothèque :
-Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Fitzgerald, W., & Bizup, J. The Craft of Research. The University of Chicago press, 2016 [LA 22 CRA]
-Boulogne A., Comment rédiger une bibliographie, Paris, Colin, coll. « Collection 128 », 2006. [LA 22 BOU]
-Boutillier S., Goguel d'Allondans A., Uzunidis D. ... [et al.], Méthodologie de la thèse et du mémoire, Levallois-Perret, Studyrama, 2018. [LA 22 MET]
-Duffau C, André, F.X., J'entre en fac : méthodes du travail universitaire en lettres, langues, arts et sciences humaines, Paris, Presses Sorbonne nouvelle, 2013. [LA 20 DUF]
-Cislaru G., Claudel C., Vlad M., L'écrit universitaire en pratique, Louvain-la-Neuve, De Boeck supérieur, 2020. [LA 22 CIS]
-Kalika, M., Mouricou, P., & Garreau, L. Le mémoire de master. Dunod, 2023 [LA 22 KAL]
-Ndukuma Adjayi K., Dobo Kuma J.J., Guide méthodologique de référence pour recherches et rédaction des écrits universitaires en sciences sociales et juridiques : L3, M2, DEA, Doctorat, Paris, L'Harmattan, 2023. [LA 22 NDU]
-Puigelier C., Terré F., Rédiger un mémoire ou une thèse, Bruxelles, Bruylant, 2022. [LA 22 PUI]
- Guide complémentaire :

